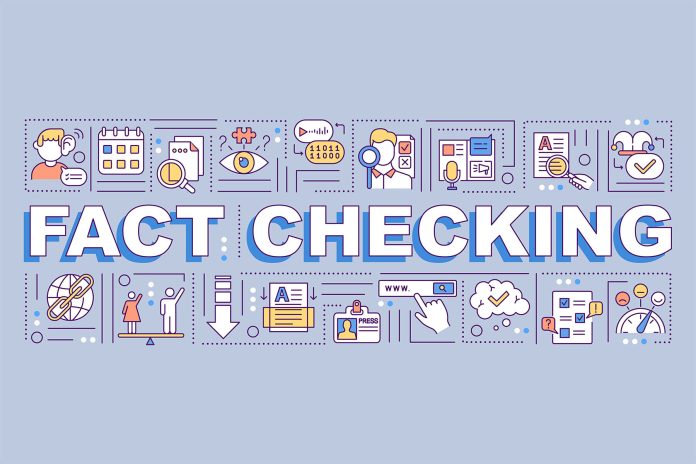Dans l’univers numérique d’aujourd’hui, une vérité simple semble s’être perdue : la liberté d’expression n’est pas un privilège, c’est un droit. Pourtant, une armée de nouveaux arbitres autoproclamés, les fact-checkers, a pris d’assaut l’espace public sous prétexte de lutter contre la désinformation. Mais qui contrôle réellement ces contrôleurs de la vérité ?
« Nous allons nous débarrasser des fact-checkers — ces contrôleurs d’information — et les remplacer par des notes de la communauté, similaires à celles de X, en commençant par les États-Unis. », vient d’annoncer Marc Zuckerberg, le patron de Meta. Rappelons que Facebook a mis en place en 2016, quelques mois seulement après l’élection de Donald Trump, un dispositif de vérification par des tiers des informations partagées sur ses plateformes, destiné à lutter contre les fake news. Ce programme rémunère plus de 80 médias à travers le monde, dont l’Agence France-Presse en France, ABC News et l’Associated Press aux États-Unis.
Mark Zuckerberg semble aujourd’hui changer légèrement de position. Selon lui, les récentes élections marquent un basculement culturel, avec une priorité accordée à la liberté d’expression. Il critique également les gouvernements et les médias traditionnels, qu’il accuse d’avoir poussé à une censure croissante. Il annonce aussi la suppression de certaines politiques de modération sur des sujets tels que l’immigration et le genre, politiques censées être inclusives mais qui, selon lui, ont été utilisées pour étouffer des opinions contraires. « C’est allé trop loin », déclare-t-il.
Il précise enfin que les systèmes de modération automatisés vont être revus. Zuckerberg admet qu’il y aura désormais moins d’erreurs entraînant la suppression injustifiée de contenus ou de comptes innocents, même si cela implique d’intercepter moins de mauvais contenus. En 2021, Facebook avait supprimé le compte de Donald Trump, limitant ainsi sa parole publique.
Enfin, Zuckerberg annonce le déplacement de son équipe de sécurité et de modération des contenus de Californie au Texas pour éviter toute accusation de parti pris pro-démocrate.
Une noble cause devenue outil de manipulation
À l’origine, le fact-checking semblait être une initiative louable : vérifier les faits, démêler le vrai du faux et offrir une information fiable aux citoyens. Mais très vite, le vernis s’est fissuré. Ce que l’on nous présente comme une mission journalistique neutre est souvent teinté d’idéologie, de biais politiques et d’intérêts financiers.
Prenons un exemple simple : en pleine pandémie, certains sujets, comme les traitements alternatifs ou les effets secondaires des vaccins, ont été traités avec une sévérité presque inquisitoriale. Toute opinion divergente, même argumentée, était systématiquement qualifiée de « désinformation ». Pourtant, quelques mois plus tard, des faits auparavant qualifiés de « fake news » sont devenus des vérités incontestables.
Quand les chiens de garde mordent les mauvaises cibles
Des déclarations de Mark Zuckerberg, le patron de Méta, il faut simplement admettre que le système a dérapé. Les algorithmes de modération automatisée, épaulés par des fact-checkers humains, n’ont pas seulement supprimé des contenus problématiques — ils ont aussi réduit au silence des voix légitimes, des experts reconnus et des citoyens ordinaires.
Le cas de Joe Rogan, célèbre podcasteur américain, en est un exemple frappant. Accusé de propager des fake news après avoir parlé de l’ivermectine comme traitement potentiel du COVID-19, il a été harcelé par les médias traditionnels. Pourtant, des études ultérieures ont montré que ses propos n’étaient pas dénués de fondement. En France, souvenons-nous des déclarations de certains fact-checkers qui assuraient que le pass sanitaire ne deviendrait jamais obligatoire pour accéder à certains lieux. Aujourd’hui, ces mêmes voix se sont tues, discrètes face à leurs erreurs monumentales.
Glenn Greenwald, journaliste d’investigation de renommée mondiale, connu pour avoir révélé les pratiques d’espionnage massif de la NSA grâce aux révélations d’Edward Snowden, ne mâche pas ses mots :
« Toute personne qui se décrit comme spécialiste de la désinformation est un escroc. Ce métier n’existe pas. » Le journalisme est régi par une éthique, une charte, une déontologie. Soit on les respecte, soit on les trahit. Mais entre les deux, il ne peut y avoir de zone grise.
Les fact-checkers ne se contentent pas de vérifier les faits. Ils orientent, hiérarchisent et souvent filtrent l’information. Ils agissent comme des gardiens du temple idéologique, déterminant ce qui peut être dit et ce qui doit être réduit au silence.
Mark Zuckerberg a compris que ce système était devenu contre-productif. En annonçant la fin du règne absolu des fact-checkers, il a reconnu implicitement que leur pouvoir avait été détourné de son objectif initial.
Quid de l’Afrique ?
En Afrique, la liberté d’expression est une conquête fragile. Si certains pays, comme le Sénégal ou le Ghana, se targuent d’une presse relativement libre, d’autres, à l’instar de l’Égypte, de l’Éthiopie et même du Bénin, restent sous une surveillance stricte. Dans ce contexte, l’arrivée des fact-checkers aurait pu servir à renforcer la transparence et la lutte contre les manipulations. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus nuancée.
Des plateformes comme Africa Check ou des projets de vérification financés par des ONG internationales jouent un rôle important. Toutefois, leur indépendance pose question. Qui finance ces projets ? Quelles lignes éditoriales suivent-ils réellement ? Le financement par des géants du numérique comme Facebook ou Google soulève des interrogations légitimes sur leur capacité à rester impartiaux, surtout lorsque les intérêts économiques et politiques s’en mêlent.
Aussi, dans plusieurs pays africains, les gouvernements ont rapidement compris l’intérêt stratégique des fact-checkers. Des alliances tacites ou explicites se sont parfois nouées entre autorités locales et plateformes numériques pour censurer des voix critiques sous couvert de lutte contre les fake news.
Ainsi, au Nigeria, des activistes et journalistes indépendants ont vu leurs comptes suspendus après des campagnes coordonnées les accusant de propager des « fausses informations ». Au Bénin, le journaliste et activiste Comlan Hugues Sossoukpè a été contraint à l’exil. En Ouganda, la période des élections a révélé à quel point les outils de modération pouvaient devenir des armes politiques. À quoi sert un fact-checker lorsque les citoyens n’ont même plus accès à l’information brute ?
Aussi, les algorithmes de modération, souvent calibrés pour les réalités occidentales, ne prennent pas en compte les subtilités culturelles, linguistiques et politiques africaines. Combien de contenus parfaitement légitimes ont été supprimés par erreur, simplement parce qu’ils étaient rédigés dans un langage africain mal interprété par les systèmes automatisés ?
Vers une nouvelle ère de liberté numérique ?
L’ère des fact-checkers touche-t-elle à sa fin ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c’est que leur crédibilité est sérieusement ébranlée. Les citoyens, de plus en plus informés et critiques, ne se laissent plus berner par des « certificats de vérité » distribués par des entités parfois financées par les mêmes plateformes qu’elles prétendent contrôler.
La vérité ne peut être monopolisée par une poignée d’individus ou d’organisations. Le retour à une liberté d’expression authentique, même imparfaite, est une nécessité démocratique.